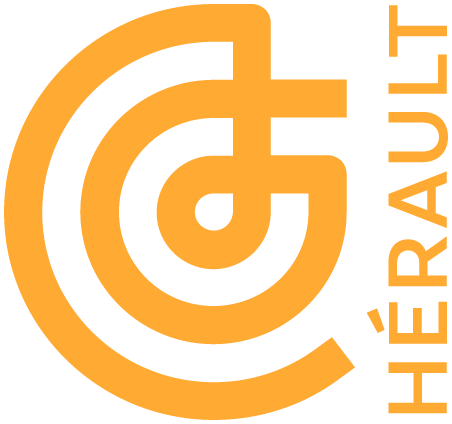Le décryptage bimensuel de l'actualité juridique et statutaire
NUMERO 79 - Janvier 2026
Si l’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline constitue une garantie, il ne résulte, ni de l’article 14 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, ni de l’article L.532-5 du code général de la fonction publique, qu’un avis écrit soit obligatoire si le sens de ce dernier a été communiqué sans délai et que les mentions du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline comportent des mentions suffisantes.
Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
N’a pas le caractère d’une telle mesure la décision de mise à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire qui entre dans le champ des dispositions du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, qui ouvrent droit à la liquidation et à l’entrée en jouissance immédiates d’une pension.
Afin de garantir le libre consentement du fonctionnaire à la rupture conventionnelle, le délai de rétractation ne peut courir à son égard que s’il est effectivement en possession d’un exemplaire de la convention, signé des deux parties.
La date à prendre en compte pour apprécier si le fonctionnaire a exercé son droit de rétractation dans le délai imparti, est celle de l’expédition du courrier et non celle de sa réception par l’employeur.
Le refus de rupture conventionnelle par l'administration n'est révisable que si cette décision est entachée d'incompétence ou d'un vice de procédure, et si elle est fondée sur un motif entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit ou de détournement de pouvoir.
Le fait qu’un stagiaire ait été condamné à une peine d’emprisonnement pour des faits de violence sur son ex-conjointe, constitue un manquement grave aux devoirs de son état, en particulier à l’exigence de dignité, et justifie le prononcé d’une sanction.
Par suite, au regard de la gravité des faits reprochés, le maire est fondé à prononcer la sanction la plus lourde applicable aux fonctionnaires stagiaires, l’exclusion définitive du service, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé donnait satisfaction dans la réalisation de son travail et que les faits délictueux n'ont pas été commis à l'occasion du service.
La seule circonstance qu’un agent ait appris son changement d’affectation en ouvrant une lettre posée sur son bureau ne révèle pas, de la part de l'autorité administrative, un comportement excédant l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique, alors que cette mutation, qualifiée de « mesure conservatoire » et « momentanée », s'inscrit dans le cadre des relations conflictuelles que l’intéressé rencontraient avec certains collègues dont il s'était plaint, et dont il avait pu s'expliquer au cours d'une réunion avec sa hiérarchie.
A cette occasion, ce changement d'affectation avait été évoqué, il était donc prévisible.
Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à se plaindre que l’administration a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du « choc émotionnel » qu’il a ressenti à la lecture de la lettre, dans la mesure où il n’a pas été victime d'un évènement présentant un caractère soudain et violent.
La pathologie anxiodépressive liée à la procédure disciplinaire dont a fait l’objet un agent, est imputable au service, dès lors que la sanction prononcée à son encontre a été annulée pour excès de pouvoir, en ce que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas établis.
Par suite, et alors que l’intéressé a vécu cet événement comme une véritable injustice, sa pathologie doit être considérée comme liée à cette procédure de sanction, qui ne peut être regardée comme procédant de l'exercice normal du pouvoir disciplinaire.
NUMERO 78 - Janvier 2026
La loi du 22 décembre 2025, dite loi Gatel, marque une étape importante avec la création d’un statut de l’élu local, destiné à renforcer l’attractivité des mandats et à mieux protéger les élus dans l’exercice de leurs fonctions.
Face à la baisse des vocations et à la complexité croissante des responsabilités locales, le législateur entend :
- Sécuriser l’engagement des élus,
- Améliorer leurs conditions d’exercice,
- Mieux accompagner l’entrée et la sortie de mandat.
Principales mesures à retenir :
- Facilitation de l’engagement : allongement du congé électif pour les candidats salariés et meilleure information des élus en début de mandat.
- Revalorisation des indemnités : hausse ciblée des indemnités des maires et adjoints, en particulier dans les petites communes.
- Amélioration des conditions d’exercice : droits et obligations des élus désormais codifiés, facilitation des autorisations d’absence, reconnaissance des employeurs engagés dans la démocratie locale.
- Renforcement de la protection des élus : extension de la protection fonctionnelle à tous les élus victimes de violences ou de menaces, et renforcement des règles de transparence et de déontologie.
- Sortie de mandat mieux accompagnée : valorisation de l’expérience acquise (VAE), amélioration de l’allocation de fin de mandat et des droits à retraite pour certains élus exécutifs.
La majorité des dispositions s’applique à compter du 1er janvier 2026, avec des rapports attendus pour évaluer l’impact financier et organisationnel de la réforme.
Lien :Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local
La loi portant création d'un statut de l'élu local doit permettre de mieux reconnaitre et favoriser l'engagement local dans la perspective des élections municipales de 2026.
Ce texte prévoit notamment une revalorisation ciblée des indemnités des maires et des adjoints pour les communes de moins de 20 000 habitants, le bénéfice automatique de la protection fonctionnelle à l'ensemble des élus victimes de violence, menace ou outrage, la suppression du conflit d'intérêt public-public, des aménagements de scolarité pour les élus étudiants, une amélioration de la situation matérielle des élues en situation de congé maternité, une extension des congés de formation et des congés électifs, ainsi qu’un élargissement des frais spécifiques pris en charge pour les élus en situation de handicap qui couvrent désormais « l'aide de toute nature ».
Enfin, le texte élargit le bénéfice de la Dotation Particulière Elus Locaux (DPEL), qui prend en charge certains frais liés à l'exercice des mandats locaux, à l'ensemble des communes de moins de 3 500 habitants, avec une compensation par l'Etat, afin d'éviter toute baisse pour les communes qui en bénéficient déjà aujourd'hui.
Lien : Réponse n°4131 du 23 décembre 2025 publiée au Journal Officiel, page 10517
La loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 instaure un cadre légal pérenne pour la protection sociale complémentaire (PSC) des agents publics territoriaux, en transposant dans le Code général de la fonction publique un accord collectif national signé le 11 juillet 2023.
Quels sont les objectifs de cette réforme :
- Généraliser, dans la fonction publique territoriale, les contrats collectifs à adhésion obligatoire en matière de prévoyance. Un décret devra notamment déterminer les cas de dispense d’adhésion à un tel contrat ;
- Modifier la participation minimale des employeurs territoriaux à la complémentaire prévoyance de leurs agents. Cette participation, conformément à l'accord de 2023, est fixée à la moitié du montant de la cotisation ou de la prime individuelle dû par l'agent ouvrant droit aux garanties minimales, qui est évalué à 70 euros. Le reste à charge pour l'agent sera donc moins élevé qu'aujourd'hui. Depuis le 1er janvier 2025, les employeurs territoriaux doivent participer à hauteur minimum de 7 euros par mois à la garantie prévoyance de leurs agents.
La date d’entrée en application de ces mesures était initialement fixée au 1er janvier 2027 au plus tard. Les sénateurs l'ont repoussée au 1er janvier 2029 pour les collectivités qui ne disposeront pas de contrat collectif à la date de publication de loi, afin de leur laisser le temps de lancer les appels d’offres et de préparer les procédures pour conclure ces contrats. Les dates d’application pour les collectivités qui disposeront d’un contrat collectif en cours ont également été ajustées.
Le texte sécurise, par ailleurs, la prise en charge des agents en cas de succession de contrats ou d’arrêts de travail à la date d'effet du contrat collectif à adhésion obligatoire. Un régime dérogatoire est, en particulier, créé pour les agents qui se trouveraient en arrêt de travail à la date de mise en place du premier contrat collectif à adhésion obligatoire : ces agents ne seront obligés de souscrire à ce contrat qu’après avoir repris leur activité pendant au moins 30 jours consécutifs. Les sénateurs ont complété ce point pour imposer à l'employeur, au moment de la prise d'effet du contrat collectif, d'informer ses agents en congés de maladie sur la possibilité d'y adhérer avant la fin du régime dérogatoire.
Rappel : Le plafond de la Sécurité sociale correspond au montant maximal des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations, principalement les cotisations d’assurance vieillesse de base, et sert également de référence pour la définition de l’assiette de certaines contributions et le calcul des droits sociaux.
L’arrêté du 22 décembre 2025 fixe, pour 2026, le plafond mensuel de la sécurité sociale à 4 005 euros (contre 3 925 euros en 2025) et le plafond journalier à 220 euros (contre 216 euros en 2025).
Ce plafond affiche une augmentation d’environ 2,04% par rapport au niveau de 2025.
Ces valeurs s’appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2026.
Lien : Arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026
Une revalorisation du SMIC de + 1,18% est prévue par le décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
Elle portera celui-ci à 1 823,03 € bruts mensuels, à compter du 1er janvier 2026.
Lien : Décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance
A compter du 7 décembre 2025, le décret supprime l'obligation de retour dans l'administration pour une durée d'au moins dix-huit mois continus pour le fonctionnaire souhaitant renouveler sa disponibilité pour convenances personnelles au-delà d'une première période de cinq ans.
Dans les faits, le renouvellement peut donc être demandé de manière continue sans interruption obligatoire. Les absences longues peuvent être anticipées (même s’il est recommandé de veiller à maintenir un lien entre l’agent et la collectivité).
Les modalités de gestion du droit à la conservation des droits à l'avancement du fonctionnaire, placé en disponibilité et qui exerce, durant cette période, une activité professionnelle, sont simplifiées : l'obligation annuelle de transmission des documents justifiant de sa situation est remplacée par une obligation unique à son retour de disponibilité.
Le nombre maximal d’autorisations d’absence prévu au quatrième alinéa de l’article L. 1225-16 du Code du travail est de cinq par procédure d’agrément
A noter : ces dispositions sont transposables aux agents publics.
Le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire est tenu d'organiser un entretien professionnel qui a pour objet, notamment, d'apprécier ses résultats professionnels et sa manière de servir au cours de l'année écoulée.
Par suite, le fait qu'un agent ne se rende pas à cet entretien, sans aucune justification, est constitutive d'un manquement à ses obligations professionnelles, susceptible de justifier une sanction disciplinaire.
A cet égard, l’intéressé ne peut faire valoir que le refus de se rendre à un tel entretien n’est pas fautif, en soutenant qu'il s'agit d'une simple garantie offerte aux agents publics.
En cas d’absence prolongée du supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire durant l’année en cours, le supérieur hiérarchique de niveau immédiatement supérieur est seul compétent pour la conduite de l'entretien d'évaluation annuel de l’agent au titre de l’année précédente, et pour l'établissement du compte-rendu de cet entretien.
Par suite, un agent n’est pas fondé à contester son CREP au motif que l’entretien a été conduit par son N+1 en raison de l’absence de sa supérieure hiérarchique directe qui était en congé de maternité depuis le début de l’année.
Il ne saurait, par ailleurs, être déduit de la seule circonstance que l'entretien s'est déroulé six semaines après le début du congé de maternité, que le N+1 n’avait pas la capacité d'apprécier la manière de servir de l’agent, alors que sa supérieure avait rédigé un document relatif à son comportement en service durant l'année précédente.
Les droits du CPF ne peuvent plus être utilisés lorsque le titulaire du compte a fait valoir ses droits à la retraite.
Par suite, la condition tenant à ce qu'il soit en activité pour mobiliser les droits acquis sur son CPF n'étant plus remplie pour suivre sa formation, l’administration est fondée, en application des dispositions du 1° de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, à abroger, sans qu'aucun délai ne lui soit opposable, la décision créatrice de droits intervenue avant la radiation des cadres de l’intéressé lui accordant le bénéfice de l'utilisation des droits inscrits dans son compte.
La circonstance que l’administration ait été informée par « de sources multiples émanant de services multiples » qu’un agent technique soit suspecté de détourner du matériel de bricolage entreposés dans les ateliers dont il a la responsabilité, en vue de les louer sur un site internet dédié, présente un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour qu'une mesure de suspension ait pu être légalement appliquée à l’intéressé dans l'intérêt du service, afin de permettre la réalisation d’une enquête administrative pour déterminer la provenance du matériel mis en location.
A cet égard, l’agent n’a pas été en mesure de justifier en être le propriétaire, alors que la plupart des outils étaient comparables à ceux utilisés aux ateliers et pour certains de la même marque.
L’agent placé en disponibilité d’office pour raison de santé et déclaré apte à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé, peut faire l’objet d’une radiation des cadres pour abandon de poste, dès lors qu’il ne s’est présenté, ni dans son service, ni à la convocation avec le médecin de prévention, afin de finaliser l'aménagement de ce poste.
L'absence de précision donnée à l’intéressé sur les conditions exactes de sa reprise ne l'ayant pas mis dans l'impossibilité de se présenter sur son lieu de travail, il n'est pas fondé à soutenir que, faute pour elle d'avoir précisé les conditions de l'aménagement de son emploi, l’administration ne pouvait constater qu'il avait rompu le lien l'unissant au service.
Un agent contractuel suspendu étant privé de rémunération pendant la durée de cette mesure, il ne saurait, durant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération en raison de son placement en congé de maladie.
Par suite, l’administration peut légalement refuser à l’agent concerné de le placer en congé de maladie au motif qu’il est suspendu de ses fonctions.